Accueil |
Articles |
Photos |
Profil |
Contact |
LIVRES D'ASIE DU SUD
Salman Rushdie règle ses contes
Thèmes: Culture |
Asialyst, 28 septembre 2016
Avec Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits, Salman Rushdie, l’écrivain d’origine indienne, dénonce le fanatisme religieux et la montée de l’irrationnel. Mais il se livre surtout à une exercice virtuose et jubilatoire de raconteur d’histoire.
Patrick de Jacquelot
 En nommant son nouveau roman Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits, Salman Rushdie nous montre d’emblée dans quel univers il nous mène : celui des contes. Car, oui bien sûr, deux ans, huit mois, etc, cela correspond précisément à mille et une nuits – à condition de ne pas être une année bissextile, évidemment. Mais un conte imaginé par cet auteur britannique d’origine indienne dont l’œuvre maîtresse demeure Les enfants de minuit ne peut qu’être quelque peu tordu, joyeusement trafiqué, à en dérouter Schéhérazade elle-même…
En nommant son nouveau roman Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits, Salman Rushdie nous montre d’emblée dans quel univers il nous mène : celui des contes. Car, oui bien sûr, deux ans, huit mois, etc, cela correspond précisément à mille et une nuits – à condition de ne pas être une année bissextile, évidemment. Mais un conte imaginé par cet auteur britannique d’origine indienne dont l’œuvre maîtresse demeure Les enfants de minuit ne peut qu’être quelque peu tordu, joyeusement trafiqué, à en dérouter Schéhérazade elle-même…
Ecrit après Joseph Anton (Folio), autobiographie de la vie qu’il a menée dans la clandestinité suite à la fatwa décrétée contre lui par l’ayatollah Khomeini en raison de ses Versets sataniques, Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits s’inscrit dans une veine beaucoup plus légère : un conte en abyme. Le texte se présente comme écrit mille ans dans le futur pour raconter des événements devenus mythiques, forcément, puisque survenus à notre XXIème siècle, mais résultant directement d’un prologue arrivé huit cents ans plus tôt… Dans cette histoire vertigineuse, tout commence en effet en Andalousie à la fin du XIIème siècle, quand Dunia, une jinnia (la femelle du jinn, comme chacun sait), tombe amoureuse d’Ibn Rushd, philosophe plus connu sous le nom d’Averroès. De leur union naît une abondante descendance mi-jinn mi-humaine qui se trouvera jouer un rôle considérable à notre époque contemporaine. C’est en ce XIIème siècle également que commence le grand affrontement entre Averroès et le philosophe Ghazali, affrontement qui perdurera jusqu’à nos jours, les deux hommes n’étant pas du genre à cesser de polémiquer sous prétexte qu’ils sont morts. Pour résumer en deux mots : Ghazali prêche une dévotion totale et absolue à Dieu, Ibn Rushd jette les bases de la pensée rationaliste et scientifique.
 |
L'auteur Salman Rushdie (Crédit : Publicity photo_Syrie Moskowitz) |
Leur affrontement trouve un écho direct dans le pays des jinns, le Monde Magique. Les jinns noirs sont du côté du fanatique Ghazali, tandis que Dunia défend bien sûr Averroès. Quand, après plusieurs siècles de fermeture de toute communication entre les deux mondes, les barrières s’ouvrent (à notre époque, donc), les jinns obscurs envahissent la Terre. Leur objectif : « instiller la peur, car seule la peur peut pousser le pécheur à se tourner vers Dieu » en répondant aux injonctions de Ghazali. Pour ce dernier, « la peur est le destin de l’homme. L’homme naît dans la peur, la peur du noir, de l’inconnu, des étrangers, de l’échec, des femmes. C’est la peur qui l’amène vers la foi, non parce qu’il y trouve un remède mais parce qu’il accepte le fait que la crainte de Dieu est le sort naturel et légitime de l’homme ». Cette offensive des jinns noirs pour semer la terreur dure deux ans, huit mois et vingt-huit nuits, et se révélerait irrésistible si Dunia ne venait à la rescousse. Pour se faire aider dans sa lutte contre les grands ifrits (les plus puissants des jinns), la jinnia fait appel à quelques-uns de ses nombreux descendants humains. Des descendants qui se révèlent dotés de pouvoirs magiques : flotter au-dessus du sol, détecter instantanément le mensonge, maîtriser la foudre, etc. Ils ne sont pas à moitié jinn pour rien… L’affrontement se révèle titanesque et met le monde à feu et à sang avant une issue heureuse : les jinns noirs sont repoussés et la frontière entre les deux mondes se referme pour toujours.
Le message véhiculé par ce conte est transparent : Rushdie, qui s’y connaît, dénonce le fanatisme religieux, l’intolérance, le terrorisme, la montée de l’irrationnel… La métaphore est parfois totalement transparente. L’auteur décrit par exemple les « Zélés » qui sévissent dans « le pays de A. » et qui ont « étudié à fond l’art d’interdire : en très peu de temps ils avaient interdit la peinture, la sculpture, la musique, le théâtre, le cinéma, le journalisme, le haschich, le droit de vote, les élections, l’individualisme, le désaccord, le plaisir, le bonheur, les tables de jeu, les mentons rasés (chez les hommes), le visage des femmes, le corps des femmes, l’éducation des femmes, le sport pour les femmes, les droits des femmes ». Pas besoin de chercher beaucoup pour comprendre que le « pays de A. » est l’Afghanistan. Sa dénonciation du fanatisme religieux est cependant beaucoup plus fine que cela. Après l’exclusion des jinns noirs du monde des hommes, à la fin du roman, nos lointains descendants, un millénaire dans le futur, mènent une vie paisible, calme, mais ils ont perdu quelque chose : leurs nuits sont devenues « muettes », sans rêve. Parfois, ils « aimeraient que leurs rêves reviennent », parfois même ils aimeraient « faire des cauchemars »…
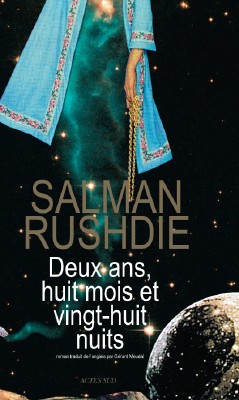 |
L’essentiel du roman, cependant, n’est pas dans la dénonciation des maux de notre époque mais bien dans le récit lui-même, la jouissance du conte. C’est un registre que Rushdie a souvent abordé. Ses deux romans pour enfants, Haroun et la mer des Histoires (Folio, 1990) et Luka et le feu de la vie (Folio, 2010) sont deux petits bijoux en la matière, des contes qui peuvent séduire aussi bien les adultes que les jeunes lecteurs. Son œuvre la plus célèbre, Les enfants de minuit (Folio, 1981), s’inscrit dans le registre du « réalisme magique » avec de nombreux éléments fantastiques dont, déjà, comme dans Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits l’idée d’un groupe d’enfants doués de pouvoirs magiques. Un quasi-thriller comme Shalimar le clown (Pocket, 2005) comprend lui aussi des éléments fantastiques.
Ce nouveau roman constitue une sorte d’apothéose dans ce registre. En bon lecteur des Mille et une nuits, Rushdie tisse son conte et des contes dans le conte, en un processus qu’il décrit ainsi : « Et voici qu’à présent, le coffret chinois se dépouillait à toute vitesse de ses strates l’une après l’autre et que, à chaque épaisseur qui s’envolait, une nouvelle voix racontait une nouvelle histoire dont aucune ne parvenait à sa fin parce que le coffret trouvait inévitablement une nouvelle histoire au milieu de chaque récit en cours, de sorte que la digression finit par apparaître comme le véritable principe de l’univers, que le seul véritable sujet c’était la façon dont le sujet ne cessait de changer (…). » Mais la virtuosité de Rushdie est telle que le lecteur s’y retrouve parfaitement et suit son ou ses récits à travers toutes leurs convolutions.
Le plaisir d’écrire de l’auteur se manifeste par une explosion de citations et références dans tous les domaines possibles et imaginables. Dans quel autre roman verrait-on apparaître côte à côte des débats philosophiques du XIIème siècle, Astérix, Spinoza, Woody Allen, Batman, un mini-traité de gastronomie vénitienne, etc ? Rushdie mêle avec délectation les éléments caractéristiques des contes des Mille et une nuits et ceux de leurs homologues contemporains, les romans de science-fiction (les jinns passent d’un monde à l’autre en empruntant des « tunnels spatio-temporels » !).
Les références les plus inattendues apparaissent à chaque page et il faudrait un livre beaucoup plus épais que Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits pour les recenser toutes. La culture indienne de Rushdie apparaît par exemple dans différentes allusions à l’actualité politique telle la victoire du parti nationaliste hindou aux dernières élections générales. Mais seuls les lecteurs très au fait de l’Inde contemporaine verront dans l’un des petits contes inclus dans le roman, celui de « la maison grande comme un boulevard vertical », construite par « un homme très, très riche » et faite non pas de brique ou d’acier « mais bien de l’orgueil le plus pur », une satire de l’extravagante résidence que Mukesh Ambani, le plus riche industriel indien, a édifiée à Bombay.
Aucun lecteur ne peut espérer appréhender chacune des références de l’ouvrage mais peu importe : ce qui compte, c’est cette formidable érudition, joyeuse et universelle, sérieuse comme futile, qui nourrit le récit et multiplie les clins d’œil – un peu comme a pu le faire Umberto Eco dans Le nom de la rose et ses autres romans.
L’essentiel, finalement, c’est le plaisir du texte. Faisant parler le narrateur du quatrième millénaire, Rushdie écrit : « Nous sommes la créature qui se raconte des histoires pour comprendre quelle sorte de créature elle est. En parvenant jusqu’à nous, les histoires se dépouillent de l’époque et du lieu, perdent la spécificité de leur origine mais gagnent la qualité de pures essences et deviennent simplement elles-mêmes. » Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits : une histoire qui est « simplement elle-même » et c’est énorme.
A lire
Deux ans, huit mois et vingt-huit nuits par Salman Rushdie, Actes Sud, septembre 2016, 316 pages, 23 euros.
Accueil |
Articles |
Photos |
Profil |
Contact |